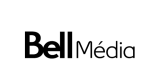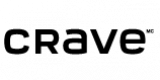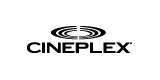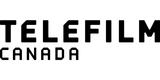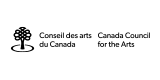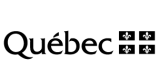Vendredi, 1er décembre 2017
Projeté en première aux RIDM devant deux salles combles, DPJ, long métrage documentaire de Guillaume Sylvestre, prend l’affiche dès aujourd’hui à la Cinémathèque québécoise (Montréal), au Cinéma Le Clap (Québec) et à La Maison du cinéma (Sherbrooke). Une projection aura également lieu au Paraloeil (Rimouski) le mardi 5 décembre. Plusieurs séances auront lieu en présence du réalisateur pour des discussions avec le public après les projections. À noter qu’une version écourtée du film sera présentée prochainement sur les ondes de Canal D.
> Voir les horaires de projection
Synopsis officiel: Un regard frontal et sans complaisance dans l’étourdissante machine du Département de la Protection de la Jeunesse du Québec (DPJ). En suivant le travail des travailleurs sociaux et des éducateurs qui doivent parfois prendre des décisions aux lourdes conséquences pour plusieurs enfants et leurs parents, DPJ propose un huis-clos intimiste dans le malaise d’une société, une plongée étouffante vers une humanité brisée, entre douceur et violence, technocratie et compassion, espoir et désespoir.
Après quelques documentaires sur le sujet, pourquoi as-tu décidé à ton tour de t’attaquer à ce sujet?
Tout le monde entend parler de la DPJ. C’est une institution fondamentale au Québec et malgré ces films, plutôt des pamphlets tournés en cinq jours, ça m’intéressait de voir ce qu’il y avait en arrière des murs de la DPJ, avec évidemment tous les préjugés que le monde peut avoir. Mais je ne voulais pas y aller brusquement, donc ça a pris du temps [le projet à pris plus de trois ans, NDLR]. Puis, la communication de la DPJ a ouvert les portes de l’institution. Ça ne s’était jamais fais comme ça. En rentrant dans ce système, j’ai vu une bureaucratie très rigide, forcément la loi l’est. Mais à travers ce cadre légal très strict, il y a des gens, des travailleurs sociaux, qui sont en première ligne. Ils jouent avec les zones les plus fragiles de la nature humaine. À chaque instant ils doivent prendre des décisions, comme s’ils avaient des bombes à désamorcer. Et ils font leur travail avec énormément d’humanité, dans un cadre complexe et inhumain. Donc c’est ce contraste qui m’a interpellé. La réalité est très nuancée, il n’y a pas de coupables.
Au départ je voulais peut-être plus faire un film sur les jeunes, mais ce sont eux les travailleurs sociaux qui m’interpellaient. Parfois, ils travaillent pendant des années, trois quatre cinq ans, avec les familles pour qu’elles gardent leurs enfants, pour qu’elles se reprennent en main. J’ai tourné sur une période d’un an, justement pour mieux sentir l’évolution des rapports qu’ils entretiennent avec leurs clients. Se donner le temps, c’est important pour comprendre ce travail.
Comment s’est passé le processus de préparation et de production?
Ça a été très long, surtout la paperasse, les cessions de droits, le travail avec l’organisme. Mais le travail avec les travailleurs sociaux s’est très bien passé, ils m’ont fait confiance. J’ai développé des rapports avec eux, mais aussi, étrangement, avec les familles. Personne ne s’intéresse vraiment à elles. Il faut les traiter avec respect, même si ce sont souvent des parents inadéquats... tous ces gens aiment leurs enfants. C’est rare les cas à la DPJ ou les parents sont des tortionnaires. On en voit quelques cas qui sortent dans les médias, mais c’est un épiphénomène.
Quand tu allais dans des familles, est-ce qu’elles étaient au courant de ton rôle?
Au départ, je rencontrais les gens, puis au fil de nos rencontres, ils savaient que je faisais partie des meubles, que ce soit possible que je sois là ou non lors de leurs rencontres avec les personnes de la DPJ. On a tissé des liens. En restant en retrait sans intervenir, et en les traitant avec respect, ils m’ont accepté.
Est-ce que les intervenants et les familles ont vu le film?
Oui, quelques-unes... en fait je pense que seule Sylvia [la protagoniste du film qui quitte la surveillance de la DPJ à ses 18 ans, NDLR]. Mais les intervenants l’ont vu, oui. Eux trouvent que ça représente avec nuances leur travail. Ils étaient très contents.
Le fait que ce soit un portrait très nuancé des intervenants, as-tu l’impression d’aller à l’encontre de ce qui est en général véhiculé sur la DPJ?
C’est sûr que ce qui fait réagir à propos de la DPJ, ce sont les mauvaises décisions. Mais il ne faut pas oublier qu’ils ne réparent pas des voitures. Il ne faut pas oublier non plus que les travailleurs sociaux sont tributaires des décision du tribunal. Donc quand on remet un enfant dans sa famille et que l’on sait que ça va «péter», c’est la décision des juges. Ce sont ces cas-là qui sortent dans les médias. Les succès de la DPJ, le travail quotidien sur le terrain, ça intéresse moins de monde. Les mauvaises décisions quand tu joues avec les vies, ça fait de bons reportages. Mais reste que malgré certains écueils, ce que j’ai vu c’est que la DPJ reste un filet social fondamental.
Parle-moi un peu de ton approche personnelle par rapport à ce sujet sensible, presque explosif.
Je n’ai pas de leçon à donner. Ce que j’ai voulu montrer, c’est le malaise du Québec. Montrer ce que les gens n’aiment pas voir. C’est une partie de la réalité, ce n’est pas de la fiction. Et aussi montrer la complexité du sujet. On a tendance à toujours condamner. À voir le coupable et la victime. Mais c’est tellement plus compliqué que ça. On est dans des zones de gris en permanence. J’ai voulu mettre le spectateur dans cette position. Tout le temps un pieds dans le vide.
Quelques lueurs d’espoir parsèment le film. Est-ce que d’après toi, il y a quand même des portes de sortie pour ces jeunes?
Dans le cadre de la loi, ils font ce qu’ils peuvent. La loi exige que tout soit fait pour que les enfants soient restent dans leur milieu familial, sauf si leur intégrité physique et psychologique est directement menacée. La ligne est mince. Des fois, ton instinct te dis «mais retirez-les, ça a pas de bon sens!»... Ce que j’ai vu pendant un an, c’est le contraire. Souvent quand on s’attarde à quelque chose, on se rend compte que c’est le contraire de ce que l’on nous dit.
Dans le cas de l’adoption, quand tu es avant l’âge de deux ans, avant le stade critique, lorsque les enfants sont placés en adoption, jusqu’à l’âge de 18 ans, en général, c’est la meilleure chose qui peut arriver. Dans le film, la mère qui accepte de confier son enfant à l’adoption, c’est par amour lui lui, ce n’est pas parce qu’elle ne veut plus s’en occuper. C’est parce qu’elle se sent incapable. Ce petit garçon qui a deux ans et qui était déjà en famille d’accueil, va être adopté... ces enfants-là, ils sont sauvés. S’ils restaient dans leur milieu, c’était fini. C’est pareil pour la jeune fille, elle s’est signalée elle-même parce que sa mère était devenue tortionnaire avec elle. Si elle était restée avec sa mère, elle serait morte. Elle a fait deux tentatives de suicide. Donc oui, le placement, l’adoption ça peut avoir des effets positifs. Et ça ce sont les jeunes qui sont passés en centre jeunesse qui nous le disent. Indépendamment de ce système rigide, dans ces centres, ils rencontrent des gens formidables durant leur parcours. Des éducateurs extraordinaires, totalement dévoués.